les ombres t’entourent
le murmure du vent
module tes songes
en un bruissement soyeux
dans le feuillage
de l’arbre d’oubli
P. Rosin
un reste de beau pour le reste du jour
"J’ai longtemps habité sous de vastes portiques"… Non. L’auteur, lecteur de Baudelaire, ironise, lui, et complète autrement le vers de La vie antérieure, pour parler de la vie présente et du passé. Mémoire, toute vie qu’on raconte est antérieure, mais pas un rêve. Réelle, concrète, avec joies et tristesses, heureux aboutissements et regrets. Ordinaire, d’abord.
"J’ai longtemps habité une boîte à chaussures
une vie ordinaire
ni trop grande ni trop étroite"
Douce ironie, que ce détour d’un vers célèbre. Et ainsi une intention est posée. Refus des rôles qu’on s’invente pour magnifier des moments qui n’étaient pourtant pas encore ceux de notre vrai accès à nous-même. Et lien avec le grand poème qui suit, je émigration, qui explique précisément qu’ici, pas de vastes portiques… Mais "longtemps" signifie aussi une rupture. La "vie ordinaire" revendiquée a aussi été le temps d’une mise au monde de soi créateur. C’est un peu ce que nous racontent ces poèmes. La réalité d’une présence au monde tel qu’il est, des refus, et l’obtention du possible qui était en germe. Et alors, lui, "fait poète" par lui, en sachant suivre ses "chemins de hasard et de fantaisie".
Et le peintre est là, qui regarde. Cependant le paysage est dehors et dedans. C’est "le regard tourné vers soi" qui rend la perception possible, opération de mise à jour, par le dépouillement des "sédiments / qui s’effritent", ces couches de soi qu’on lâche simplement en les sachant.
Mais la vie se poursuit, et il y a autrui, dans la mémoire et le présent. Paradoxe du "dire", avec ce "goût du silence", du "retrait", des mots qui laissent "à distance".
En même temps qu’on lit on regarde les dessins-peintures. On tourne les pages et on revient aux reproductions, car la correspondance est totale entre les textes et les lignes entrelacées qui figurent un personnage qu’on peut imaginer avoir "le regard tourné bers soi". Visage en transparence sur des feuillages (peut-être des feuillages) ou les traits de la pensée. Ou des algues (dit un texte, plus loin). Puis courbes et spirales formant un torse et une tête, comme devant un mur qui serait celui du poème évoquant "sur les parois / de petites taches / des griffures" (…) "de petites moisissures", et même "un reste d’écriture". Sur ce mur je vois aussi, derrière l’homme qui songe, l’esquisse d’une femme dressée, tête en arrière, claire, et des ombres plus sombres ou à peine tracées de gris, et peut-être un vieillard à barbe blanche. C’est comme pour les formes sur des affiches déchirées, que le hasard a créées. Je vois, devine, invente. Mais la main de celui qui dessine-peint a laissé des traces qui font sens, si on veut entrer dans le mystère des formes. Surtout quand il nous donne des indices, et l’écrit.
"en marge d’anciennes tempêtes
lambeaux de rêves solitaires et gris"
Et "les souvenirs se dispersent". Dans la mémoire et sur le papier.
Laissant d'abord les poèmes je regarde encore, plus loin, mais le texte en face de l’image donne des clés. On voit le personnage replié sur lui-même, sur un fond qui peut être de verdure. Des taches suggèrent le "jardin / aux allées tranquilles". On voit une main dont le poème désigne celle qui fait le geste, "elle touche mon épaule". Mystère : attendue, elle, dit le texte, et "près". Deux moments mêlés, et encore de l’attente dans la présence. Peut-être dans toute présence une part d’absence.
Retour en arrière, textes ("mémoire", "fissures"… "et tout effacer"). Blessures, éloignements, réflexion sur ce qui lie et délie. Résumé.
"chaque rencontre est un miracle"
(…)
"chaque rencontre est un mirage"
Lisant je retrouve encore l’univers d’un dessin. Algues, mes feuillages…
"une forme qui passe
des algues flottent en silence
dans la pénombre
dans ses replis
tous savent
le goût du naufrage"
Sommes-nous tous des naufragés avec des chagrins gardés en soi ? Pour qui "une larme de pollen se pose
fragile au coin des yeux".
Naufragés sauvés par "l’arbre d’oubli" ? Autour de cet arbre doit-on tourner neuf ou sept fois comme en ce rituel triste inventé par le roi Agadja afin de soumettre des hommes ? Alors on oublierait les racines et les gens. Sans espoir d’arbre du retour.
Peut-être à cause des "mystères", des "secrets", de vécus "impénétrables" cachés, intimes. Il ne dit plus simplement "je", là, mais "on" et "nous". Universalité des expériences. Puis il revient au "je", interrogeant ses "visages qui s’ignorent", le "masque dessus", la solitude et les regrets. Partage, en soi, des catégories qui sont tous les pans de la vie, rangés comme dans des boîtes, plus ‘un espace libre’. Celui, sans doute, où naît la création.
"mais qui a besoin de comprendre le chant des oiseaux"… Pas de ponctuation, donc pas de point d’interrogation - mais une question, qui affirme en même temps un secret de l’art. Ce secret est dans la sagesse du poète qui sait "la dureté des choses" mais choisit de la taire (au moins un peu…) pour "qu'elle ne ferme pas nos yeux à la beauté du monde". D’ailleurs la tendresse est là, aussi. Et "la douceur des mots", une chance pour "un reste de beau pour le reste du jour".
Une autre reproduction, en face d’un poème sur un "bord de mer", une silhouette de femme vue de dos.
…...
je, émigration
Très différent, ce grand poème. L’histoire familiale, l’exil, l’Histoire, aussi, celle avec le H majuscule. L’intégration, les douleurs, non sues, puis sues. La conscience vient ensuite, avec le temps (mais même un bébé se souvient).
"la solitude la peur
le rejet
cela
je ne le savais pas
je l’ai compris plus tard"
Et le paradoxe de la survie gagnée "contre soi", de la perte de la transmission car "celui qui se retourne / se transforme en pierre".
Histoire de migration émigration. "On part
on change de nom
de visage."
Pensant à ce qui aurait été sans l’exil familial on sait que l’histoire aurait été différente, et soi aussi.
"mon regard ne serait plus le même
je serais un autre"
Tous les exilés le savent. Leurs parents parlent "derrière une vitre", des savoirs échappent, un écran les brouille, car la vitre est une protection qui fait effacer ou taire, et l’incompréhension aussi est une protection de qui écoute, pour ne pas se transformer "en pierre".
Mais
"Peu à peu
au fil des jours
la vitre s’est faite miroir
j’y vois mon image et des ombres passent."
Pour ce grand texte le dessin est très sombre. Les ombres ont envahi le mur et elles dessinent une treille comme une prison (celle du père ? Histoire avec majuscule… ou celle de la mémoire des douleurs de ceux dont on vient). Le visage est un masque, le corps est pris dans des barbelés noirs. La mémoire trans-générationnelle de l’exil est une douleur, même quand pour soi l’exil a finalement peut-être été une chance.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
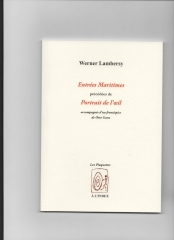 Entrées maritimes, précédées de Portrait de l’œil, de Werner Lambersy, 2020
Entrées maritimes, précédées de Portrait de l’œil, de Werner Lambersy, 2020
Je marchais sur les sciures du soleil et les cendres encore chaudes du crépuscule (…)
W. Lambersy
Portrait de l’œil
Après le titre je regarde le frontispice d’Otto Ganz, dont j’ai déjà vu (et apprécié) quelques reproductions d’œuvres. Je retrouve le même univers. Des couleurs intenses et sourdes (comment dire ?). La couleur est ce qui frappe d’abord, attire, du bleu-gris au rose-mauve, le blanc de crânes chauves, ronds comme des lunes (et peut-être la lune, aussi), des taches rouges, comme des flaques de sang sur un fond, un mur, ou un dôme de ciel, au-dessus d’un personnage au dos large, mais voûté, face à un visage, d’un autre qui ne le regarde pas, lui aussi corps comme ployé sur lui-même, sous un poids. Peut-être le même devant un miroir imaginaire, regard vers le bas. Taches rouges, flaques. Alors, relisant le dernier poème (Entrées maritimes) je relève ce vers "Je traversais des fleuves de sang". Mémoire, naissance dans la guerre des anéantissements.
Portrait de l’œil est constitué de fragments en prose, le plus souvent de trois lignes, parfois quatre (rarement), une fois six, deux fois deux. Et une seule fois, tout au début, une seule ligne. Justement pour noter une marche solitaire, qui semble être encore dans le "songe".
"Je marchais seul : qui pourra me dire où j’étais…"
Peu de ponctuation forte, dans ces pages. Rares points d’exclamation ou d’interrogation. Points de suspension pour ce qui est très bref, tout au début. Des virgules, cependant. Majuscules, comme des pointes pour commencer les fragments. Un trait d’œil. Mais on remarque vite que l’espace qui les sépare peut nous tromper. Car il n’en fait pas des textes fermés sur eux-mêmes. Souvent on glisse d’un texte bref à un autre par un enjambement. Donc on doit chercher pourquoi cette structure…
Mais déjà les exergues que l’auteur a choisis peuvent donner des indications sur le sens et la forme. D’abord, la "fenêtre sur la mer" de Ruy Belo, que, dit-il, "nous avons tous"… Or cette fenêtre symbolique est un espace, un cadre, qui n’englobe pas tout, malgré l’idée qu’elle contient d’une amplitude d’horizon et d’une profondeur (cet exergue, comme d’autres éléments des pages qui suivent, nous renvoie au titre du poème final - un de ces fils tissés entre les deux parties du livre). Donc, cadre rectangulaire, comme les lignes sous nos yeux. Même si, comme pour Henri Michaux ouvrant sa tente au réveil, on soulève "la paupière d’un géant". Ample est le monde regardé ici par l’auteur du Portrait de l’œil, et autant intérieur qu’extérieur ("Je viens depuis dedans" écrit Enrique Huaco, et donc Werner Lambersy). Ample monde à scinder, pour aider le lecteur à passer d’un espace vu à un espace déchiffré "depuis dedans", ou passer du dedans au dehors. Pour dire que l’espace entre les lignes est celui d’un cillement d’œil.
Cependant "la paupière d’un géant" (Michaux) représente aussi la part immense de cet œil sollicité pour voir au-dehors et voir en soi. Profondeur des "simples lumières" (Ariane Dreyfus) et de "l’obscurité" (Erri De Luca).
Cillement d’œil, l’espace au creux des phrases, et respiration. L’enjambement c’est aussi comme une apparente hésitation avant le pas, le choix. Séparer un verbe d’un complément, un sujet d’un verbe, c’est accentuer le mot qui précède la rupture formelle, visuelle, lui donner du poids, forcer l’attention.
Autre raison, la lenteur. Méthode d’accès au sens.
"Il suffisait lentement, lentement de soulever un peu de peau tendre et je verrai, plus loin et hors de moi, éclater une lumière qui joue à la marelle avec les grands espaces du lotissement des astres"
Remarquez la place de la virgule. Entre les deux adverbes, et pas avant ou après chacun d’eux. Virgule cillement et respiration.
Espaces dans la page, méthode encore, pour figurer ce que je lis ailleurs. Paliers ("je remonte au jour par paliers de transparences"). Les fragments comme des marches pour descendre et remonter du fond de la nuit, et de l’océan de la mémoire consciente et inconsciente.
Il marchait, il marche. Les premières pages sont entre réel et rêve. Le réveil avec les sons du réel, mais des images qui viennent "du puits de la nuit".
Revenir de mirages nocturnes offerts peut-être par le sommeil, ou, comme Erri De Luca, issus de contemplations en "fidèle à l’obscurité", celle qui donne à voir autrement…
"J’étais tombé de la queue d’une comète avec de la poussière d’atome dans les yeux et des ballets de libellules..."
Attendre du monde qu’il tienne "les promesses audacieuses que les étoiles ont faites avant de disparaître".
Entre soi et soi, depuis ce "regard en boule de cristal du cerveau" et le regard "plus loin". Un exercice intérieur de l’œil, "lentement, lentement". En lui un monde, des mondes. L’œil même est un univers, la pupille une "cathédrale". Mais "dieu n’est pas là", malgré "un reste d’encens (…) dans l’air". Vanité des "prophéties", "visions", et "songes"…
Il y a les images, l’amour (corps et âmes), mais la guerre, et "beaucoup de larmes" entre humains. Donc "dieu n’est pas là", et pourtant il y avait "encore le frémissement invisible des anges auxquels il est bon de croire"…
Le poème, ce long poème de prose en fragments, à travers ses pages interroge sur ce que le monde réel avait peut-être tenté de nous dire, "que nous ne comprenions". Ce qui existe, non-humain, parle sans "la moindre langue", ou avec un langage "caché dans les étoiles".
Qu’est-ce que "l’autre côté de l’œil" où les choses retrouvent une réalité antérieure ? Le lieu de l’ordinaire des jours ? Ou le signe que l’œil peut deux sortes de regards, et que d’une bascule à l’autre il saurait saisir ce que "la pierre, les plantes, les animaux" disent. L’oreille aussi saurait entendre "des sons inouïs (…) venus de nulle part".
Et pourtant…
"Combien de fois faudra-t-il repeindre à la chaux de toutes nuances des couleurs de l’arc-en-ciel le malheur des pauvres, la misère sans espoir et l’horreur des enfants malades ?"
Oscillation de la pensée entre des promesses de sens, dans l’écoute possible de plus que nos langues, et une réalité qui échappe à la "grande idée que de vivre et d’inventer l’existence".
La rose et l’abeille "ne s’inquiètent pas"…… /…... "De quitter la table". Nous oui, qui pensons la mort et tenons à nos rêves, avec notre "œil insatiable".
Oscillation, encore, entre corps "scaphandre pesant", ou "cosse somnolente", et "l’autre côté des miroirs de la chair", où peut être appelée la "lumière".
"Lumière, diffuse encore, rejoins-moi (…), rejoins-moi j’ai besoin d’être plus large que la cosse somnolente qui me tient"
Cette lumière appelée n’est pas que du jour. Ce n’est pas non plus "la lumière noire qui fonde le monde". Ce serait ce qui déchiffrerait ce noir fondateur. Désir de sens, rejoindre la joie des dauphins, et "nager en pleine lumière comme un vitrail éclairé à midi". Conscience d’un savoir venu de ce "mystère intérieur" qui peut être "maître de voir l’invisible", et conscience des échos de ce savoir.
L’enjeu serait de pouvoir à la fois "porter l’invisible" et "toucher du doigt le visible". Alors il serait possible de "goûter à l’infini" au-delà des limites charnelles. Alors il pourrait "côtoyer l’immense", comme l’oiseau dans son vol. Et traverser l’écran qui cache "notre âme" ? Toujours aller vers ce que peut-être on pourrait comprendre, le tentant "jusqu’à brûler nos yeux".
On peut le suivre dans la vision d’un abandon au vol et se "laisser porter comme un noyé depuis les origines gazeuses, les galaxies et les planètes". Plus difficilement, douloureusement, si c’est dans l’agitation de "gestes ridicules"... Toujours ces heurts entre des images contraires, le sublime est proche, tentant, et le trivial le rattrape (sans l’annuler). Et finalement, on aborde de nouveau au poème - dernière page, avec l’expression qui sera le titre du grand texte qui suit, "les entrées maritimes du poème".
……
Entrées Maritimes
Récit de vie et de poésie comme essence de soi.
"Je suis né poète"
Mais les réalités du temps n’offraient aucune évidence pour que la poésie soit affirmée, reconnue et puissante (quand il serait l’heure). Brutalité de l’Histoire, secousses de l’infâme.
En exergue le mentir vrai, non d’Aragon, mais d’Hugo Pratt, l’identité juive ("Juif naturellement et cependant Ulysse") de Benjamin Fondane, mort début octobre 1944 à Auschwitz, et les "histoires pour tenir" que nous inventons tous, dit Jean-Louis Giovannoni.
Car la douleur est là dès la naissance. La guerre, la mort. Et il faudra trouver comment dire.
"Je grandissais sous des agonies"
Pouvoir dire et savoir comment c’est reconnaître la force de la colère.
"Je suis né poète
Naître n’est rien sans la colère"
La poésie est, quand affleure la conscience des "ténèbres" en soi. Mémoire.
Mais aussi… quand on se sait poète, "né poète"…
"Pour dire ces choses secrètes
Que personne pas même moi
N’écoute chanter"
Et
"Pour avoir rappelé ce qui s’est
Passé bien avant que
Le temps ne paraisse éparpillé"
Douleur, vie, amour, mort, mémoire, Histoire, chant secret, la poésie écrit tout cela, que le poète sait.
"Car nous sommes poème et néant"
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 La peintre le sait-elle ?, de Jean-Claude Bourdet, 2021
La peintre le sait-elle ?, de Jean-Claude Bourdet, 2021
noir de mes pensées
nostalgie
porté par la pleine conscience
le sensible de mon corps
JC. Bourdet
La peintre le sait-elle ?
En exergue, une citation d’Edmundo Gomez Mango, psychanalyste qui s’intéressa aux liens entre psychanalyse et littérature et traduisit Baudelaire en espagnol. Dans la phrase choisie ici il évoque le travail poétique et psychanalytique sur le langage et son pouvoir, "le faire des mots".
Peu de reproductions des peintures de Sylvie Basteau, trois. Mais notre regard passera par les mots de Jean-Claude Bourdet pour en imaginer d’autres. Un texte introductif de Gilles Jallet insiste sur le fait que les poèmes ne sont pas dans une démarche descriptive, ce qui effectivement serait le piège, tout autant que cet autre piège, en poésie, celui des créations graphiques ou photographiques qui veulent illustrer des écrits. Car ce n’est certainement pas ainsi qu’on peut aborder une parole en marge de regards peints. Cela Jean-Claude Bourdet en a le savoir et l’instinct.
La peintre le sait-elle ? Le titre reprend un vers qui introduit un questionnement sur ce qui souterrainement agit dans les tableaux, ce qui les précède et accompagne.
Pour regarder il faut entrer dans les rêves et pensées que l’artiste a transformés en traits et couleurs, et rêver avec elle, penser comme elle, dans un temps de silence de sa pensée propre. Ainsi fait le poète, évoquant ce qui peut-être a nourri l’imaginaire pour la peinture, ce qui, en marge, dans les faits de vie, de culture, de hasard, a créé un univers. Mais aussi il laisse, dans les interstices entre les vers, se poser la matière de ce qu’il voit, lui, par ce qu’il est, et qu’aucun autre ne verrait ainsi. La question est aussi une indication sur le processus de création, et, si ce n’est affirmation, c’est une connaissance proposée sur le non-savoir dans la conscience qui crée. Le processus se produit, il n’est pas dirigé par un vouloir et une maîtrise. La peintre sait-elle d’où vient cet abandon qui crée ? Sait-elle que c’est par l’abandon qu’elle crée ? Sait-elle ce qu’elle produit sur autrui ? Et sait-elle que son inconscient rencontre celui de qui regarde ?
Le poème dit le geste de la main qui peint. On sent comment le corps a dû impulser le trait pour en faire un cercle, partant du centre d’elle et jaillissant en "courbes", "volutes de sable". Important cette présence du corps de celle qui peint, en marge du regard sur les tableaux. Car c’est l’élan d’un corps qui crée et c’est un corps qui a regardé avant d’écrire ce qui "s’arrondit". Avant, "un frisson me saisit et m’entraîne".
Par cela il y a rencontre de ce qui peut être lu, sur les toiles, de l’Histoire, et "de temps immémoriaux". Autour des peintures, évocation de voix, musiques, et textes. On regarde dans un monde sans virginité culturelle et, dans le même temps, le poème, tout en notant ces références associées, procède à une mise à nu, pour qu’il n’y ait plus que le tableau et les mots pour dire le tableau. Dire c’est écrire en marge en mêlant nature ("les acacias célestes") et culture ("une mythologie incertaine"). Mettre en mots les formes non décrites, c’est devenir comme la peintre, provoquer une fusion de conscience, une écoute. "tu es nous sommes, oiseau lumière".
Structure du recueil. Après ce premier voyage en peinture, un cycle de sept textes, pour sept jours, titré Jour après jour. Suit Éclats, série de tercets, regard encore. Puis des poèmes dans le rythme du début. Boucle.
Le Cycle des sept jours est différent. Comme si la parole sur les tableaux avait provoqué, ou autorisé, un parcours intérieur, "porté par la pleine conscience". Affleure la mémoire, de visages, des présences, "aïeuls", ou "fils" (qu’on est ou qu’on a…), des souvenirs d’impressions, d'émotions (la vie la mort). Comme si les tableaux avaient ouvert une brèche pour l’écriture poétique, étaient un écran de projection. Film et conte de celle qui peint, film et conte de celui qui écrit. Un miroir.
"n’oublie pas de vivre
dit Écho à Narcisse
le papier de soie se dépose délicatement sur ta toile
envol"
Lectures, lectures. Tous les livres aussi sont des miroirs. Ceux dont il inscrit des titres, pour leur rapport avec l’univers des tableaux, évocations qui viennent spontanément et qui, sans doute, parlent aussi de l’inconscient et à l’inconscient. Cheminement proposé vers plus de pensée dans le réel.
"tâtonnement Illusion
ton âme perçoit
l’ascension de réalité"
Éclats… Ceux de la toile. Couleurs, "lumière", "reflets", "éclaboussures". Éclats que ces tercets qui captent des bribes du "pinceau nourricier". Éclats que ces "traits / argent et or", et ces mentions d’animaux suggérés par les toiles.
Puis, de nouveau, strophes plus amples autour de la peinture. Danse avec la lune. Poème, longuement, pour ce tableau avec ses traits de blanc et un monde à imaginer. Son "récit", "écrit dans une langue inconnue non déchiffrée", avec son "flou", sa "cosmogonie troublée", ses "mythologies narratives". Mais, création picturale ou poétique qui traduit ("Je dis le traducteur"), toujours "L’inconscient reste maître du logis". C’est pour cela que des métamorphoses opèrent dans le tracé des toiles, cette "langue inconnue" qui utilise des figures de style qui voilent et dévoilent ("métonymies"), une grammaire qui déroute ("anamorphoses"). Et c’est pourquoi on peut déchiffrer sans trahir.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
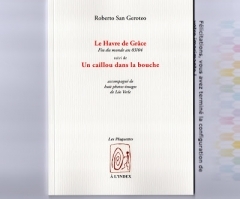 Le Havre de Grâce, suivi de… Un caillou dans la bouche, de Roberto San Geroteo, 2021
Le Havre de Grâce, suivi de… Un caillou dans la bouche, de Roberto San Geroteo, 2021
"Quand Jean-Claude Tardif m’a proposé de lui passer quelque chose pour cette collection, il m’est venu très vite l’idée de lui donner enfin ces poèmes écrits au Havre (…) Et de réunir ces poèmes arrachés à la folie ordinaire entre deux trains. (…)
Je n’ai pas pu m’empêcher de mâcher ces lambeaux de paroles qui ont fini par s’écrire. Et en les relisant aujourd’hui, ils me disent quelque chose de ce temps, du coup encore vivant, en marge d’une certaine rouille de la mémoire, une fossilisation certaine du souvenir."
R. San Gertoteo, La vie dis-continue (texte posé en postface du recueil)
…
Le Havre de Grâce
L’auteur précise, dans un texte (cité ici en exergue), et qui est en fin de recueil, d’où viennent ces poèmes, dont il dit qu’ils furent griffonnés comme malgré lui "entre deux trains" et restés en attente, par lui qui ne veut pas trop écrire ("surtout ne pas donner dans la graphomanie"). En exergue de ces lignes, une citation d’Ernst Herbeck, qui dit de la poésie qu’elle est "la forme orale de l’empreinte de l’histoire au ralenti". Cela convient à l’écriture et à la pensée d’un auteur qui est résistant en son essence, si on lit Histoire avec un H majuscule, et au poète qui s’intéresse autant aux êtres croisés, témoins de détresses ou de misères, qu’à l’histoire sans majuscule, faite des souvenirs individuels.
Ce premier ensemble, en vers libres, a comme sujet de garder "empreinte", mémoire, de faits privés et de faits sociaux, dans une période qui fut d’engagement social. les deux réalités se tissant ensemble.
Textes auxquels il reconnaît (en les relisant longtemps après) une nécessité (même si lui n’emploie pas ce mot), car écrits avec le sentiment d’une "urgence", et pour avoir été glissés, dit-il, comme "dans une bouteille à la mer". Cette urgence, en lisant on la retrouve.
Des photos-images (collages-montages) de Léo Verle interprètent librement ses sujets.
Dans ma lecture, je suis aidée, bien sûr, par ce ce que j’ai pu lire de lui, et notamment ce volume d’Empreintes/À L’Index (2011), La machine à se souvenir.
La mémoire…
Roberto San Geroteo dit beaucoup, mais dans son écriture, un paradoxe. Notations fortes de sentiments intenses, et une retenue, aussi, pour préserver une part de silence, peut-être. Une pudeur de l’esprit.
Premier poème, Lettre ouverte. Trouble d’une parole à une femme qui peut-être ne l’a jamais reçue et lue. Peu importe pour le poème, qui est l’occasion de penser "passion" et "compassion", vérité ("Et toi, sais-tu encore être vraie ?") et masques ("scrupules, mensonges, danger"). Lui quand il écrit est (n’est plus que) "le souvenir de sa voix". Il est court, ce beau texte, mais il semble résumer toute la complexité des liens que des êtres nouent, se croisant pour un peu de temps ou plus longtemps, se perdant. Déchirements, peur, mémoire. Une voix dans un présent, dans un souvenir. Mais le temps a passé et le poème au singulier prend une signification plus large. Il peut être un chant qui s’adresse à d’autres visages, cumulant pour le lecteur d’autres mémoires, le faisant s’en saisir pour y entendre d’autres voix. La distance du temps donne aux poèmes une force particulière, une signification plus juste, pour avoir traversé les années justement. Alors, au lieu de relire le texte qui suit on cherche ceux qui correspondent au même thème. Car d’autres poèmes sont des portraits solidaires d’êtres que l’Histoire a marqués (ou la solitude sociale).
Poèmes au féminin, des messages de tendresse et tristesse parlent (V.O., À Chostakovich) d’une musique venue "d’une lointaine souffrance".
Trop violente la beauté de "cette mélodie".
"Les cordes de leur douceur
et leur stridence
tranchent et scient la voix qui me reste."
Que veut-il dire de ce retour d’elle "jusqu’à l’obscure enfance" ? Serait-ce que la vérité dans l’amour passe par la perte des masques sociaux des adultes ? La nudité qu’il réclame ("revenir / la plus nue possible") est-elle seulement celle du corps ? Ou bien plus, si le corps met à nu la vérité d’un être.
Il était une fois. Titre comme pour un conte, mais poème synthèse. La vie en résumé entre "joie immense" et "tristesse infinie". Naissance d’un amour, la joie, rencontre et partage. Usure, tristesse, fin du lien. "Il est l’heure de retourner le sablier." Le temps est le coupable, et le regard qui change ou ne sait plus ("yeux vides"). La vie n’est pas le conte.
Dernier poème du Havre de Grâce, deuxième Lettre ouverte. Le manque, l’absence.
L'auteur des photos-montages, lui, associe les femmes (corps nu ou yeux) à l’éventail du premier poème. Objet comme une conque marine pour la naissance d’une Vénus imaginée. Ou éventail-masque cachant un possible sourire (ou un mensonge) et se faisant complice de l’orage et du "tourbillon" de la lumière (premier poème) ou du temps (poème au sablier).
Mais la fin du dernier poème dépasse le manque, vers la joie, par la promesse du vrai regard, celui qui s’adresse à lui "pour ce qu’il est : le propre et le singulier".
D'autres poèmes sont des regards portés sur autrui. Société, portraits de passants, de fraternités.
Ainsi un solitaire désespéré, recherché, menacé.
"rongeant toujours le même os
en silence
comme s’il s’agissait d’un coeur de silex"
Ainsi un ouvrier sénégalais "bientôt à la retraite", et ses yeux "fraternels".
……
Un caillou dans la bouche
Dans cette partie ce sont des "fragments d’un journal en miettes", inspirés, dit-il, par "la tradition japonaise du haïku". Tercets, surtout, ou poèmes très fragmentaires, dispersés, par deux, sur l’espace de pages nues.
En exergue, Issa, et sa grenouille qui "a les larmes aux yeux", et Marina Tsvetaieva, pour "un caillou dans la bouche" (cet obstacle à la soif mais pas à la parole, dit-elle, sceptique et ironique). Cette expression empruntée sera un vers d’un des derniers poèmes, et, donc, le titre. Forte image, ce caillou, car on peut y voir la volonté de limiter l’écrit à l’essentiel (d’où la brièveté des "miettes"), tout autant que la difficulté à sortir les mots pour se faire entendre.
Brièveté mais densité, intensité.
Deux évocations, Mahmoud Darwich (l’homme qui "lance des pierres au soleil"), et Franz Kafka ("tout oublier (y compris son nom) / sauf l’enfance"), et Dora…
Visages, yeux, feu du partage, mémoire de voix (la mère, le père, la langue), mémoire des amis, des morts, le chant, la neige, l’été… Fourmis, piments, enfance, musique, cigales, oiseaux, aube. Tout un univers de perceptions, de moments captés.
Comme c’est écrit dans le dernier tercet, après l’évocation d’une "petite maison blanche" (mais ce pourrait être pour tout ce qui est présent dans ces textes brefs, on trouve
"la porte entrouverte
sur le rêve".
Il y a aussi quelques notations amères. Par exemple sur la communication, avec le symbole des appels téléphoniques ratés ("nous sommes tous des faux numéros"). Mais les thèmes sont plutôt d’une présence sensible au monde, avec un goût pour les saveurs de la vie.
Citations, deux de ses tercets…
Tombe des branches
la neige
au creux des cœurs.
...
Un corps passe
à la vitesse d’un arbre
dans le désert.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 Dans l’entre-temps j’écris, de Jean-Claude Tardif, plaquette 2020 (et Noir, suivi de Métamorphose du corps noir, Éditinter 2020)
Dans l’entre-temps j’écris, de Jean-Claude Tardif, plaquette 2020 (et Noir, suivi de Métamorphose du corps noir, Éditinter 2020)
Mais nous sommes hors de portée. Loin de nous-mêmes. Dans les marges de toutes les pages que nous n’écrirons pas.
JC Tardif
Dans l’entre-temps j’écris
Le texte introductif est de Patricia Castex Menier, qui met l’accent sur les incertitudes, les doutes, exprimés dans ces pages. Sans négliger cependant qu’y soit aussi présente la vie, avec ses couleurs, et "la rumeur du monde".
Mais pas de couleurs dans les encres d’Hervé Delabarre… Non, traits fins ou très épais, taches noires, comme une calligraphie sans lettres. Une écriture, pourtant. Et on peut se donner la liberté d’y déchiffrer des formes, d’imaginer y voir des corps, des germes, des racines, l’esquisse d’un visage sans yeux, des yeux sans visage. Là aussi les interstices de "l’entre-temps", espaces de l’imaginaire, et d’une pensée graphique. Et traces de gris, cet "entre-deux" dont parle un poème.
Proses brèves, pour cet ouvrage. L’entre-temps du titre, on le voit dès le premier fragment ("l’entre-temps des heures"), et des sens à entendre ("l’interstice des mots"). On sait assez vite sur quoi portent les interrogations, répétées. Le temps, le silence, l’écriture, le regard sur soi, sur vieillir, et sur ce que l’on voit, dehors.
Mais de texte en texte je découvre autre chose. Jean-Claude Tardif écrit comme s’il peignait, comme si c’était lui qui traçait des encres, comme si l’écriture était peinture. Et que, dans le quotidien, il pense son corps écrivant en peintre. Ainsi, il met, ouvrant un volet, "la main sur ce bleu, dedans", pour que, de cette couleur sa paume en soit "nourrie". Et s’il parle de "poème plus noir encore" ce n’est peut-être pas seule noirceur des significations ou mémoires douloureuses. Ce peut être aussi avoir le désir d’un poème-peinture en miroir des encres tracées par le graphiste. D’ailleurs il se trahit ("L’aube : du temps esthétique"), même s’il ajoute : "Rien de plus !".
Le texte suivant n’est que fusion entre deux sortes d’écriture. Encre des mots, encre des traits, "la plume qui écrit, celle qui trace". C’est la même pour l’écrivain, mais les mots sont de peintre, évoquant "le gris, cet entre-deux que l’on hésite à définir", et "la feuille qui ne l’absorbe pas". Lisant cela on sent l’encre sur un papier épais qui pourtant n’arrive pas à la boire. Même si on sait bien que "la marge" non franchie n’est pas que de la page. Que cela donne au fragment, bien sûr, un autre sens, sur les limites de ce que l’écriture peut saisir des marges du sens, et du "tout" qu’il faudrait pouvoir inscrire, et dont il doute réussir à le capturer. Pas d’écriture sans douter.
Qui aime l’univers de la peinture, du graphisme, sait sentir "l’âcre de l’encre", même si c’est recouvert par "l'odeur rancie des feuilles". C’est un crépuscule de saison, d’émotions, de "parfums" venus aussi de la mer. L’encre, c’est plus fort.
Couleurs, encore. Le "mauve", ce "contre-jour" (des "veines" ou de la "pierre"), un "entre-deux" visuel et de conscience que le poète doute de pouvoir inscrire comme le ferait une peinture ("Sur le papier, mes mots n’en disent rien").
Traces, de nouveau, geste plus pictural que scriptural. "Du bout des doigts l’on trace des signes, empreintes." Dans cette page je vois aussi une clé pour déchiffrer les encres d’Hervé Delabarre et les poèmes. Ces "runes" qui sont des signes ancestraux d’une culture pas tout à fait disparue, voués à tenter de deviner qui on est, ce dont on rêve, ou à inventer le futur. Symboles venus "d’enfance". Mais signes de ce que voudrait l’écriture, l’inscription de formes aussi fortes que des "runes", ces alphabets mystérieux dédiés à traduire des mondes intérieurs.
L’encre sert à tracer, mais c’est une matière. "Je regarde l’encre traverser la peau, battre." Puis il y a le sable, "grain à grain". Le temps, sans doute, écoulement d’infra-secondes (sablier ou plage ou rêve). Mais comment ne pas penser aussi au sable du grain de la feuille où inscrire des taches et dire "l’entre-temps".
Oui. "Forcer le noir et sa lumière." Penser une "empreinte" réelle (plage), signe du "temps passé", et faire des poèmes qui soient des empreintes, comme le graphiste fait avec ses encres.
Le regard, toujours. Senti d’abord comme venant d’un "poids dans la paume", ce qui déclenche le désir de "voir au travers" et "de remonter à la première image", revenir à la "parole" ("qu’une parole"). Comme s’il voulait se détacher de l’attrait pour la matérialité de la trace. Poète, seulement poète.
Pourtant l’univers reste visuel autrement, la pensée passant par les yeux, le corps entier regardant. Le "bleu" de la mer s’associe encore aux "couleurs qui sèchent", matérialité. Et de même, celle de la poussière "quand le doigt s’y pose".
Ayant lu celui qui peint avec ses poèmes je reviens en arrière.
Le silence, comme une interrogation lancinante. Celui qui est seule source de l’écrit. "Nous ne parlons que de silence et d’horloges arrêtées." Ou "Le poème" (…) "On l’écrira avec du silence"(…). Et celui qui est l’obstacle à franchir, un "glas" marqué par les horloges, sur lequel il est difficile de pouvoir mettre des mots, cherchés "la tête dans les mains", pour que soit dite "cette fracture" qui nous sépare du sens du temps, et qui est aussi fracture en nous, "faille", "interstice", même si la figure en est "paroi" ou "roche". Enfin, silence qu’on crée ("Il suffit de se taire, de bâtir son silence").
Doute, au sujet de cette obsession du poète, de créer, alors que "vivre" n’est pas que création. "Comme si cela ne suffisait pas."
"Dans l’entre-temps j’écris". C’est-à-dire dans cet espace non saisi qui est mystère et profondeur, en soi et dans le monde. Avec une litanie d’interrogations, de doutes. En sachant que l’objectif est peut-être inatteignable, car c’est soi qu’il faut déchiffrer, ce soi "hors de portée". Comme la saison le fait dans les jours on entre sans doute en soi "par effraction". L’entre-temps, c’est "la parole suspendue" de celui qui doute. "J’écris peut-être."
D’autant plus qu’on n’est pas seul. "Entre moi et moi, tous les autres."
Il doute, mais croit aussi au signe ineffable, ce "frisson parfois dans le creux de la paume", qui annonce "la voix", genèse de l’écrit. L’écrit qui n’est pas fantaisie sans enjeu, mais dont "le premier mot" est "l’arme pour affronter le Monde". Le mot, le poème, pour comprendre, être, et dire. Monde avec majuscule, lettre de l’inquiétude (force) et d’une possible magnificence de tout, mêlée à son contraire.
Alors il nous explique.
"J’appelle 'Monde' ce qui se trouve entre nous et ce que nous croyons savoir de nous."
Ce multiple réel fait des autres, des choses, de la nature, est comme un écran entre soi et la conscience de soi.
Évocation de la Genèse et du "vide", "pourtant", d’Attar, associé à un "chant d’oiseau", mais qui sur le silence ou le sens d’un chant "ne nous dira rien", écrit-il (comprendre... malgré son grand texte de sagesse). Car nous ne sommes que "l’incipit oublié du premier livre".
Désespérance, là. Qu’appuierait le dernier fragment, d’une ligne ?
"… S’il y a un temps pour tout, le néant me sied."
Pourtant, avant, ouverture sur "cette autre chose que nous n’osons nommer…". Pas forcément la négativité ou la mort, puisque cela s’oppose au "souffle qui poisse l’air"...
……
 Noir, suivi de Métamorphose du corps noir
Noir, suivi de Métamorphose du corps noir
Ouvrant le livre, je regarde d’abord les œuvres de Jean-Michel Marchetti, porte pour entrer dans les textes. Intenses noirs, dans l’esprit de Soulages (mais un univers propre). Couleur compacte, tant qu’on peut croire ne rien voir. Pourtant des strates décomposent la fausse apparence, apparaissent des épaisseurs lourdes, presque sculptées. Noir plus noir que le noir, puis des nuances qui tendent vers des gris (des, pas un), et des traits extrêmement fins de pointes de blanc - si fins qu’ils semblent sourdre de la matière noire, comme une écume, ou avoir été posés, glissés, comme une neige infime. Je regarde beaucoup. Et je vois (invente ?) aussi des formes.
Dans l’ordre. Une porte, solide ; des portes, dont l’une a des traces d’écriture, indéchiffrable, et l’autre est un voile, transparence vers la lumière ; une stèle (et je pense à Victor Segalen) ; un mur, et, loin, une mer d’ombre, ou un fleuve, puis un horizon de falaises ; un gouffre noir, avec deux ombres fantomatiques (une de chaque côté, fantômes des êtres qui furent), comme un tunnel obscur qui attire,un infini, et l’idée du noir cosmique, ce grand mystère où tout bascule. Je n’ai pas mentionné la peinture en couverture. Le centre plus noir est un passage (vers une grotte, une cave, une mine ?), et à droite ce peut être un pan du mur de pierre grise ou les plis de la robe d’un personnage venu du fond des temps, officiant pour un rite funéraire dans une antique nécropole. Peu importe ce que d’autres verront ou ne verront pas, préférant peut-être ne saisir que la matière de la peinture (que sur une reproduction on perçoit cependant). Mais dans tous les cas ces créations peuvent soutenir une méditation poétique, ou l’accompagner, et proposer une pensée.
......
Noir
Lire…
Simple mot du titre, car il suffit, tant en nous il résonne en chaînes de connotations. Évoque. Des peurs d’enfance, des peurs de mortels, ces "poussières d’étoiles" que dit Hubert Reeves, nés de l’éternité d’atomes venus de loin et dont on ne sait rien, mortels craignant le néant. Mais depuis Soulages et son outrenoir on ne pense plus le noir comme non-couleur de nos terreurs (ce qui ne nous empêche pas d’y songer, instinctivement). On a appris qu’il pouvait révéler la lumière.
Donc, lumière, et le premier texte dit le paradoxe du "plus encore" noir qui précède la lumière, elle venant par l’excès où peut naître une implosion lumineuse. Ou une sourde remontée.
Les sagesses nous disent aussi, autre compréhension, que pour nous, symboliquement, psychologiquement, métaphysiquement, l’épreuve du noir précède l’éveil à la connaissance de soi et du tout. Noir intérieur de la souffrance, de l’ignorance.
Noir, couleur. Si "dense" est ce noir qu’il autorise "la potentialité / d’une aube", et lui reste noir. Mais, ne pas confondre, "Le noir / n’est pas la nuit". Et si le mot est court, noir, c’est une "monosyllabique" (…) "profondeur".
De la couleur on passe au mot. Et du mot à la couleur, dont l’auteur dit sa découverte, quittant une peur instinctive ancienne. "Aujourd’hui / je sais sa lumière".
Le noir "condense le jour", écrit-il. Ne cherchant pas toujours à interpréter ce visible.
"Parfois je me dis / qu’il n’y a rien à dire // sur le noir /// il suffit de le soupeser"
Mais plus loin il rejoint l’interrogation cosmique.
"Les planètes / tournent autour de la question". C’est un "ailleurs" spatial que le noir fait rechercher. Jusqu’à penser l’impensable qu’est "la masse d’un trou noir" et douter de pouvoir "circonscrire" cela avec un poème. Un ailleurs autrement, ce noir qui "travaille en nous". Jusqu’à, peut-être, dire, "des mots / leur inconnaissance". Car ce noir d’outre-signification, il touche l’inconnaissance radicale de tout, et si le poème veut l’écrire il doit oser penser une absence, être un "poème basalte", devenir une pierre noire qui est le noir au lieu de le dire. Ce sont les derniers mots.
……
Métamorphose du corps noir
Le titre du poème se prolonge page suivante par une ligne annonciatrice du dernier vers du poème.
"… Jusqu’au grand corps noir de la lumière"
C’est comme si, après avoir fait du poème une concentration du noir en pierre, il voulait en faire ce qui absorbe la lumière ou est absorbé par ce "corps noir" conceptuel. Et c’est assez similaire. Mais passant par deux mots ("Trait / point") "à peine encrés" le poème semble chercher à atteindre un centre du noir ("ce point / noir obscur"). Mais le poème retrouve aussi la présence de la matière épaisse du noir "sous la peau" des textes de la plaquette. Cependant de la couleur on passe à ce qu’elle évoque de "ténèbres", comme "des corps / en cortège déportés".
Demeure l’attrait du poète pour le "trait / du calligraphe", pour "le souffle… dans la main", "le geste". On est dans cet "entre-temps" (la plaquette) d’un interstice entre poème et calligraphie des encres, poème et peinture du noir.
Jeu de mots sur l’âme qui impulse sa question. "Qu’a l’âme ?"
Sonorité, "calame"… Ce roseau taillé pour inscrire demande un geste très physique et il parle d’une mémoire d’écriture qui a traversé les siècles sur des tablettes, alors que de nos traces le texte note la "fragilité". L’âme, elle, cette force de conscience, rêverait de ce qui perdure, ou de plus de sens. (Plus loin c’est "l’âme du calame" qui bouge).
Écrire, tracer, mais "pour donner corps
au singulier Un"
Le noir de Soulages est mentionné pour ses "irisations", sa "géométrie". "Une autre histoire du noir"…
Noir dans le blanc, "la part sombre du blanc", et "fulgurance". Vers "l’envers / de la couleur".
Évocation de Saura, le peintre, ses dessins, pour parler de mot plus noir, cherché en vain.
Au-delà du mot c’est le corps qui est présent dans la dernière page, c’est le corps qui va réussir à perdre "lexpression", rendue "au grand corps noir de la matière".
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
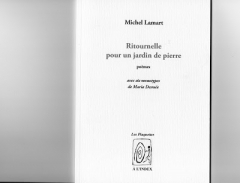 Ritournelle pour un jardin de pierre, de Michel Lamart
Ritournelle pour un jardin de pierre, de Michel Lamart
C’est le livre que je n’ai pas lu (peut-être sera-t-il réédité plus tard…). Donc je ne sais que ce que j’ai vu sur le blog d’À L’index, le livre à dire… Peu, mais assez pour constater que ses mots, accompagnés par des monotypes de Marie Desmée, doivent être un riche exercice de regard. Cela je le sais pour l’avoir lu, lui, dans d’autres textes et dans un beau dossier, Autopsier un mirage, consacré à un poète photographe, Michel Mourot, publié par À L’index (n° 38) et recensé ici. Mais le titre, lui, est là, pour faire son office de titre. C’est-à-dire, avant qu’on ait ouvert la moindre page, laisser imaginer ce que pourrait être l’ouvrage (et constater ensuite qu’on a pu se tromper, ou qu’au contraire on a eu l’intuition d’au moins une vérité des textes…). Ritournelle, c’est léger, c’est humble, un petit chant sans importance (qui ne veut pas se donner d’importance), mais c’est aussi ce qui malgré soi tourne dans la tête, avec ses refrains, ses répétitions, le léger devenant parfois triste. Et si la ritournelle est offerte à "un jardin de pierre", plusieurs possibilités (seule la lecture saura…). Je pense aux jardins zen, superbes et dépouillés, espaces de méditation, voulant signifier un détachement qui capte l’éternité. Je pense aussi aux déserts de pierre, juste avant le sable, secs (j’en connais), lieux qu’on peut aimer (adorer) et qui donnent envie d’y rester, où la seule herbe est de cailloux. Jardin de pierre, cela évoque les cimetières, où, sur les tombes, on pose des pierres en hommage. Mais la pierre peut signifier aussi ce qui est dur et froid, les déserts émotionnels, des douleurs qui figent, ou (qui sait ?) des joies qui sidèrent. En tout cas le titre est bon, qui donne à penser, en se trompant peut-être. Ou pas. (Si les significations se cumulent, ce qui est parfois le cas).
Recension © MC San Juan / Trames nomades
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
 Dans l’entre-temps j’écris, de Jean-Claude Tardif, plaquette 2020 (et Noir, suivi de Métamorphose du corps noir, Éditinter 2020)
Dans l’entre-temps j’écris, de Jean-Claude Tardif, plaquette 2020 (et Noir, suivi de Métamorphose du corps noir, Éditinter 2020) Dans l’entre-temps j’écris, de Jean-Claude Tardif, plaquette 2020 (et Noir, suivi de Métamorphose du corps noir, Éditinter 2020)
Dans l’entre-temps j’écris, de Jean-Claude Tardif, plaquette 2020 (et Noir, suivi de Métamorphose du corps noir, Éditinter 2020)
Écrire un commentaire